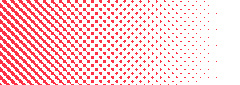Article initialement paru dans La Littérature française au carrefour des langues et des cultures, sous la dir. d’Anne-Rosine Delbart (avec la collab. de Sophie Croiset), Cahiers de linguistique. Revue de sociolinguistique et de sociologie de la langue française, n°35/1, 2009 [2010], p. 35-53.
Au-delà du dilemme diglossique
1Dans la situation excentrée et excentrique qui est souvent la sienne, l’écrivain francophone est placé devant un choix cornélien dont les termes ont été rappelés par Jean-Marie Klinkenberg (1989, 1993). Soit il gomme les traces de sa spécificité linguistique pour se conformer à l’habitus de l’Hexagone – et cela, peu importe que le français soit sa langue maternelle ou celle qu’il a adoptée pour pallier le manque d’audience internationale de la sienne propre. Ce qu’il gagne ainsi en reconnaissance, en rayonnement et en « universalité » (comme aurait dit Rivarol, lui-même le fils d’un Piémontais francisé), il risque toutefois de le perdre en « authenticité ». Soit, au contraire, il se rapproche de son public local et se réclame de cette différence porteuse d’identité. Ce faisant, il renonce cependant à la légitimité symbolique que confère la consécration par les instances parisiennes (Casanova, 1999).
2Ce dilemme est probablement sans issue en ce qui concerne le choix de la langue d’écriture, du moins depuis que le romantisme a fétichisé la langue maternelle et la langue nationale, puis projeté l’une sur l’autre… (Caduc, 1980, p. 66; Kremnitz, 2004, p. 202-219) Aussi constate-t-on que plusieurs écrivains issus des anciennes colonies françaises ou des actuels départements et territoires d’outre-mer ont délaissé cette question parfois douloureuse. Ils préfèrent projeter leur différence linguistique à l’intérieur des textes, où le conflit plus ou moins larvé entre la langue locale et le code métropolitain est « mis en texte » plutôt que mimétiquement mis en scène, selon des modalités que j’ai décrites ailleurs (Grutman, 2005). Il devient un effet d’écriture dans des œuvres qui refusent de choisir entre les lecteurs du cru et ceux du centre. Le Martiniquais Raphaël Confiant raconte par exemple que le style hybride de ses livres « fai[t] doublement plaisir : aux Français de l’Hexagone parce qu’ils retrouvent une strate profonde et oubliée de leur propre langue; aux créoles parce qu’ils ont le sentiment ou l’illusion de lire leur propre langue vernaculaire. » (1994, p. 180) On conçoit aisément l’intérêt de cette stratégie d’écriture : sortir de l’impasse décrite plus haut en instaurant une logique inclusive (ET/ET) plutôt qu’exclusive (OU/OU), et indiquer de la sorte une troisième voie à l’écrivain francophone. Le double effet dont parle Confiant, référentiaire (< référence) dans le cas des lecteurs français, référentiel (< référent) dans celui des lecteurs créoles, l’aide à échapper aux contraintes que lui impose sa situation périphérique. Naguère encore sommé de choisir entre deux parcours prévisibles : l’assimilation en vue de la reconnaissance OU l’authenticité sans rayonnement, il peut maintenant percer sans sacrifier une part de son identité.
3Dans les littératures dites postcoloniales, l’inscription de l’identité – qui devient forcément altérité aux yeux du lecteur métropolitain – se fait ainsi consciemment par et dans la langue. Sous ce rapport, la littérature antillaise s’est le mieux saisie du contentieux linguistique pour l’investir de fonctions à la fois ludiques et esthétiques. Jadis, nous rappelle Patrick Chamoiseau, il arrivait souvent au sujet diglossique d’avoir honte de son créole natal au point de vouloir l’immoler à « la divinité monolingue » en échange d’une meilleure maîtrise de la Grande Langue du Centre (1997, p. 277). Aujourd’hui, en revanche, « la douleur diglossique est utilisée comme une dynamique d’écriture », utilisation artistique que Chamoiseau considère « comme une sorte de solution au conflit linguistique » (cité dans Détrie, 1996, p. 139). La violence liée à ce dernier semble avoir été sublimée dans une écriture qu’on serait malvenu de réduire à la réalité historique qu’elle prétend évoquer. Ayant renoncé à écrire directement en créole, Chamoiseau s’exprime dans un français suffisamment marqué pour créer une connivence avec le lecteur créolophone. Le montrent les traductions « en français d’outre-mer » dont il fait suivre maint passage rapporté en créole : il les trafique à souhait, évitant par là le piège de l’exotisme. En même temps, Chamoiseau modère son « hétérolinguisme » (Grutman, 1997, p. 25-44) pour ne pas décourager le lecteur métropolitain, lequel, souvent, ne fait guère que reconnaître cette altérité sans vraiment chercher à la connaître. Sans arriver à complètement annuler la fracture diglossique qui traverse les sociétés antillaises, un roman comme Texaco (1992) ne se contente pas non plus de la reproduire.
4Si la littérature antillaise offre l’exemple le plus spectaculaire, elle n’est pas la seule à tenter de déjouer la diglossie. Le Marocain Abdelkebir Khatibi a consacré quelques beaux textes à ce qu’il appelle la « bi-langue » des écrivains maghrébins. Il s’agit bien d’un effet de diglossie, même si Khatibi emploie ce dernier terme au sens restreint de Ferguson1 (1959), le réservant à l’opposition entre l’arabe dialectal et l’arabe coranique, « entre l’oral et l’écrit, entre le parler maternel inaugural et la langue de la loi (islamique) » (1985, p. 188). Le roman maghrébin lui apparaît comme un texte pluriel, écrit en français certes, mais constamment travaillé par le substrat arabo-berbère : « toute cette littérature maghrébine dite d’expression française est un récit de traduction. Je ne dis pas qu’elle n’est que traduction, je précise qu’il s’agit d’un récit qui parle en langues » (ibid., p. 186). Dans cette glossolalie, chaque idiome fait signe aux autres : du parler maternel à la langue étrangère « se déroulent une traduction permanente et un entretien en abyme, extrêmement difficile à mettre au jour… » (ibid., p. 179). C’est néanmoins ce qu’il propose de faire dans une analyse de Talismano (1979), du Tunisien Abdelwahab Meddeb. Tels ces parchemins qu’on grattait au Moyen Âge pour pouvoir les réutiliser, ce roman-palimpseste aurait deux couches : son texte visible (français) en cacherait un autre (arabe), invisible à l’œil non averti. La couche inférieure affleurerait çà et là, sous la forme d’emprunts lexicaux dûment glosés ou de « mots pidginisés » (ibid., p. 194). Plus profondément, la syntaxe évoquerait tantôt le rythme du dialecte parlé, tantôt la récitation mnémotechnique du Coran. L’arabe dérangerait ainsi la « structure monolingue » du texte français, non seulement en le faisant plier « sous un ébranlement baroque » (ibid., p. 197) mais encore en le truffant de références aux mystiques de l’islam (ibid., p. 202-204).
5Autant de manières de jouer à cache-cache avec la langue étrangère, que cette écriture vise à contenir sans l’écraser. Car le bilinguisme, de l’avis de Meddeb (1985, p. 126) lui-même, loin de toujours « entraver » l’écriture, est « capable de la servir » :
Quand j’écris dans une langue, l’autre langue […] y travaille quelque part, délibérément et à mon insu. La présence de la langue absente dans la langue où j’écris peut, au reste, ordonner une poétique. […] Au-delà de la traduction – qui jouerait à rehausser la coloration d’un texte – [mais] en transposant les structures de l’une à l’autre langue […], il y a lieu d’obtenir une écriture prête à surprendre le lecteur en ses habitudes, le mettant face à de provocantes étrangetés, éveillant en lui le sens de l’énigme. (Ibid.)
Le « palympseste » flamand
6À première vue, ces considérations ne semblent guère valoir pour la littérature francophone de Belgique, dont les représentants actuels, de François Weyergans à Jean-Philippe Toussaint, d’Amélie Nothomb à Jacqueline Harpman (pour ne mentionner que ceux qui ont raflé des prix parisiens ces dernières années) sont non seulement de langue maternelle française mais encore reconnus pour leur maniement orthodoxe de cette langue. Il n’en a pas toujours été ainsi. À la fin du xixe siècle, Albert Giraud (pseudonyme du Louvaniste Émile Kayenberg) s’attaquait dans les pages de La Jeune Belgique à la langue de ses confrères, la trouvant assez biscornue pour la qualifier de « macaque flamboyant », tandis qu’Alphonse Allais (dans Le Chat Noir du 2 février 1889) s’en moquait dans le « Poème morne traduit du belge » qu’il dédiait à Maurice Maeterlinck: « On ne l’aurait jamais vue rire. Sa bouche apâlie arborait infréquemment le sourire navrant de ses désabus » (cités dans Quaghebeur et al., 1990, p. 13 et p. 31). C’est que quelques-uns des plus grands écrivains belges avaient développé un style bien à eux qui n’est pas sans annoncer certaines formes contemporaines de surécriture. En plus d’un parti pris d’irrégularité esthétique, bien mis en évidence par la critique (ibid., p. 109-130), il y avait là des effets pas toujours maîtrisés d’un substrat (ou plus exactement, pour les Flamands non entièrement francisés parmi eux, d’un adstrat). De ce point de vue, les calques sémantiques et syntaxiques d’Émile Verhaeren, le style artiste de Camille Lemonnier et plus tard, de Georges Eekhoud, relèvent aussi, à des degrés variables, d’une écriture diglossique qu’il importe de ne pas lire uniquement à travers le prisme du décalage linguistique par rapport à Paris.
7Il va sans dire que les écrivains en question n’envisageaient aucunement leur démarche dans ces termes, chose d’ailleurs inconcevable à l’époque. Le mot « francophonie » venait d’être créé dans un ouvrage au titre évocateur, France, Algérie et colonies, que l’on ne lit plus guère aujourd’hui. Onésime Reclus, le frère du géographe, y considère comme francophones « tous ceux qui sont ou semblent destinés à rester ou à devenir participants de notre langue ». Et de mentionner les Bretons et les Basques de France, les Arabes et les Berbères du Tell, « dont nous sommes déjà les maîtres. » Reclus hésite encore à y inclure tous les Belges, « bien que l’avenir des Flamingants soit vraisemblablement d’être un jour des Fran[s]quillons » (1886, p. 422-423)2. L’assimilation linguistique : voilà un verdict qu’on lit souvent dans des textes du xixe siècle, tant en France qu’en Belgique. Reclus n’était pas seul à croire que « le flamand périra[it] sans doute : même avec le hollandais, son frère, c’est une petite langue, parlée par peu de millions, alors que le français est une grande langue, voire une des premières sur terre. » (1886, p. 417).
8L’Histoire en a disposé autrement. Avec l’introduction du suffrage universel – pour les hommes! – en 1893, puis proportionnel, en 1899, il devenait de plus en plus difficile de dissocier le « pays légal » (auparavant composé d’une classe censitaire francophone de part et d’autre de la frontière linguistique) du « pays réel » (majoritairement non-francophone). Le grand économiste et juriste belge Émile de Laveleye voyait les signes avant-coureurs de cette évolution dès 1871. Or, au beau milieu de son analyse sociopolitique de la « Question flamande », il insère une page introspective étonnamment moderne. Elle est d’autant plus digne d’intérêt que Laveleye, alors professeur à l’université de Liège après des études au prestigieux Collège Stanislas de Paris, puis aux universités de Louvain et de Gand, avait passé son enfance à Bruges. Cette origine flamande explique le recours au « nous » dans la page en question, dont je me permets de citer un large extrait:
Nous, Flamands, qui écrivons en français, nous ne possédons l’usage facile, complet, d’aucune langue. Notre vocabulaire est restreint. Ce génie natif, intime, qui jaillit en traits de feu des lèvres du gamin de Paris et des femmes de la Halle, cette forte saveur du langage populaire que Malherbe s’efforçait de saisir dans la bouche des maraîchères, nous échappe absolument. On parle mal autour de nous et nous écrivons comme on parle. La lecture la plus attentive des bons auteurs peut tout au plus nous préserver des plus grosses incorrections; mais la fontaine vive des expressions originales, comment y puiser ? Notre cerveau est imprégné des vagues images, des traditions, des locutions, des formes grammaticales, en un mot, du « verbe » germanique, que la nourrice flamande y a implanté, et, malgré tout, cela revient et se mêle au français dont seul peut-être nous nous servons, comme les lignes d’un palympseste [sic] effacé qu’on entrevoit confusément sous l’écriture nouvelle, qui est seule visible. Même pour ceux d’entre nous qui ont [sic] été élevés en France, le français reste toujours une langue étrangère. (Laveleye, 1894, p. 140)
9Au risque d’être rangé parmi ces « critiques belges […] toujours occupés à signaler nos fautes » (ibid.) que Laveleye voue aux gémonies, j’épinglerai l’erreur de la dernière phrase (où le bon usage prescrit « ceux d’entre nous qui avons été élevés ») parce que, tel un acte manqué, elle vient admirablement illustrer le problème qu’il dénonce à l’aide d’images parlantes. Certaines sont plutôt convenues : Gavroche côtoie les marchandes de ces Halles proverbiales où, de l’avis du sieur Du Marsais, il se faisait plus de figures en un jour de marché qu’au cours de plusieurs séances académiques, ainsi que les crocheteurs du Port-au-Foin dont l’honnête homme devait pouvoir se faire comprendre selon Malherbe. Voilà autant de topoï récurrents dans le discours épilinguistique du francophone cultivé. Ils témoignent d’une part du surmoi parisien (et, par extension, hexagonal) qui hante sa conscience linguistique (« On parle mal autour de nous [c.-à-d. en Belgique] et nous écrivons comme on parle »), d’autre part du fait qu’il reconnaît la norme sans pour autant la connaître (« La lecture la plus attentive des bons auteurs peut tout au plus nous préserver des plus grosses incorrections »), décalage « générateur de tension et de prétention », comme l’avait bien vu Pierre Bourdieu (1982, p. 54).
10L’image de la nourrice détentrice du « verbe » originel (in principio erat Verbum, dit l’Évangile selon Jean) repose quant à elle sur une tradition nettement plus ancienne et non proprement française. Dans le chapitre liminaire d’un traité rédigé au début du xive siècle, le De vulgari eloquentia, Dante appelait « vulgaire » la langue « que, sans règle aucune, nous apprenons en imitant notre nourrice, quam sine omni regula nutricem imitantes accipimus. » Il opposait ce parler anarchique de la première oralité au latin, code auquel il fallait être initié (par des hommes, contrairement à la locutio vulgaris) et que l’on ne maîtrisait qu’avec le temps, au terme d’études assidues. À cause de cette priorité chronologique, Dante conclut à la plus grande noblesse du vulgaire (« nobilior est vulgaris »), phrase qui a fait couler beaucoup d’encre.
11Chez Émile de Laveleye, tributaire en cela du logocentrisme romantique, le parler natal est également promu au rang de langue originelle. Même après sa disparition, la trace en demeure, tel un signe de son absence. Ainsi, le flamand entendu et appris de la bouche de la nourrice « revient et se mêle au français dont seul peut-être nous nous servons », à tel point que même pour les Flamands formés en France, comme Laveleye lui-même, « le français reste toujours une langue étrangère. » Comme la très grande majorité de ses contemporains, Laveleye jugeait fort peu salutaire cette espèce de pollinisation croisée. La langue chronologiquement première, même oubliée, causait de regrettables interférences dans celle qui l’avait supplantée sans réussir à l’éradiquer. Dans le français des écrivains flamands, l’autre langue transparaît selon lui « comme les lignes d’un palympseste effacé qu’on entrevoit confusément sous l’écriture nouvelle, qui est seule visible. » Sa métaphore – déjà présente, au demeurant, chez les Romantiques3 – annonce moins les réflexions de Genette (1982) sur l’« hypertextualité » que les discussions entourant la langue d’écriture dans les littératures francophones issues de la décolonisation. Mais là où, un siècle plus tard, Khatibi et Meddeb signaleront et célébreront le substrat arabe, Laveleye signale et stigmatise l’existence d’un substrat flamand sous le texte français de ses compatriotes.
« Onirologie », une fiction linguistique
12Ce constat me servira de point de départ pour formuler une hypothèse concernant les œuvres des Flamands francophones du xixe siècle. Je l’illustrerai à l’aide d’un conte fantastique de Maurice Maeterlinck, « Onirologie », publié dans La Revue générale en juin 1889, l’année où parurent les œuvres (Serres chaudes et surtout La Princesse Maleine) qui allaient catapulter sur le devant de la scène parisienne ce jeune Gantois – l’article dithyrambique d’Octave Mirbeau date de quelques jours avant son 28e anniversaire, en août 1890.
13« Onirologie » est un texte manifestement marqué par la lecture d’Edgar Allan Poe. Maeterlinck (1985, p. 25-36) y développe une idée maîtresse d’un autre auteur « traduit »4 par Baudelaire, à savoir Thomas De Quincey, dont il met d’ailleurs une phrase en exergue : « Of this at least I feel assured that there is no such thing as forgetting possible to the mind » (Quincey, 2009 : 120). Cette citation des Confessions of an English Opium-Eater (1822) est à rattacher à une métaphore que ce dernier reprendra dans ses Suspiria de profundis (1845). Selon Quincey, « le cerveau humain » est un « palimpseste [!] immense et naturel » qui cache « des couches innombrables d’idées, d’images et de sentiments », refoulés peut-être (comme nous dirions aujourd’hui, instruits en la matière par Freud) mais pas disparus pour autant : « leurs couches incessantes se sont accumulées et se sont, chacune à son tour, recouvertes d’oubli. Mais à l’heure de la mort, ou bien de la fièvre, ou par les recherches de l’opium, [ils] peuvent reprendre de la vie et de la force. Ils ne sont pas morts, ils dorment. » Il en va notamment ainsi des « profondes tragédies de l’enfance », qui « vivent toujours cachées, sous les autres légendes du palimpseste » (cité d’après Baudelaire 1980, p. 297-298 ; Quincey, 2009, p. 192, 194).
14C’est précisément le récit d’un tel souvenir d’enfance ravivé par l’opium que nous livre le narrateur d’« Onirologie », un orphelin d’origine néerlandaise résidant en Nouvelle-Angleterre. La nuit du 22 au 23 octobre 1880, alors qu’il est exilé en terre américaine depuis une quinzaine d’années, il rêve qu’il se noie « au fond d’un insondable puits » et voit apparaître successivement deux femmes : une première, très vieille, qui se contente de lever les bras et d’exclamer « une incompréhensible phrase en [ce qu’il croit être du] fort mauvais anglais : The kind is in the pit ! the kind is in the pit ! ou une chose analogue » ; puis une deuxième, au visage angélique, qui l’arrache « à l’eau du puits » et l’embrasse « en [lui] parlant une langue qu’[il] ne compren[d] plus ». Ce dernier mot laisse entendre que les paroles prononcées par la mère salvatrice (car c’est d’elle qu’il s’agit, bien entendu) n’étaient pas tout à fait aussi incompréhensibles que celles, en « mauvais anglais », de la bonne. Or, je l’ai dit, le narrateur est né aux Pays-Bas : la langue qu’il ne comprend plus est celle, oubliée, de ses ancêtres. Ce n’est que bien des années plus tard qu’il l’apprendra, après avoir reçu des papiers relatifs à sa famille. Cet héritage l’incitera à étudier le néerlandais, qu’il arrive à « lire assez couramment […] au bout de deux ou trois semaines », grâce à sa connaissance de l’anglais et de l’allemand, langues germaniques apparentées. Une lettre en particulier retient son attention. Elle lui fournit, par une sorte d’illumination rétrospective, la clef du cauchemar qu’avait provoqué l’opium en 1880. Sa mère, une « faible et pâle Anglaise que l’amour avait exilée en Hollande », y raconte à son père et dans la langue de ce dernier la quasi-noyade de leur fils, alors âgé de « quatre mois et neuf jours »5 :
Utrecht, 23 septembre 1862.
... Nous étions allés cet après-midi-là […] avec la cousine Meeltje et Madame van Brammen, prendre le thé chez la tante van Naslaan, et l’agneau était au jardin avec Saartje — elle l’avait laissé seul un clin d’œil, sur le gazon ; et quand elle revint, plus d’agneau ! Elle va regarder dans le puits ; le pauvre innocent agneau était au fond ! Elle, au lieu de l’en tirer tout de suite, vint crier à notre fenêtre : « ’t Kind is in den put! ‘t kind is in den put! » (L’enfant est dans le puits ! l’enfant est dans le puits !) Je saute alors par la fenêtre du salon, et je tire de l’eau le cher agneau, qui pleurait toutes les larmes de son petit cœur, et je cours d’une haleine jusqu’à notre maison...
15Cette lettre « a réellement et à jamais déplacé l’axe de [l]a vie » du narrateur. Chose frappante, la « scène endormie au fond de l’âme » est ici de nature linguistique ou mieux, métalinguistique, contrairement à ce qui sera plus tard le cas chez Freud, pour qui la Urszene est de nature sexuelle. Le rapprochement entre le rêve anglais de 1880 et la lettre néerlandaise de 1862 tourne autour de deux phrases presque identiques : The kind is in the pit ! et Het kind is in de put !, où l’ordre, la fonction grammaticale et, à une exception près, le sens des mots sont respectés. L’exception, c’est justement le mot anglais kind, au sujet duquel Maeterlinck précise en note qu’il signifie « genre, espèce ; ou l’adjectif : bon, bienveillant », et son homographe néerlandais kind, « enfant » (auquel on pourrait ajouter l’allemand Kind, qui a le même sens, pour compléter le trio des langues attribuées au narrateur). On voit bien comment Maeterlinck se joue de ses lecteurs unilingues et les met sur une fausse piste : en traduisant par « genre » ou « espèce » le substantif kind qui suit l’article défini, ils obtiendraient une phrase absurde. Il trafique donc ses traductions, art de la feinte que perfectionneront un siècle plus tard un Chamoiseau ou un Réjean Ducharme.
16Par ailleurs, le lien entre les mots néerlandais [kind] et anglais [kaind] n’est jamais explicitement établi par le narrateur, qui insiste au contraire sur le fait que « le rêve est toujours muet » : « tous ses personnages marchent, parlent et agissent au milieu d’une matière molle et singulièrement insonore. » Il suppose donc de notre part sinon une connaissance (passive ?) des langues en question, du moins une volonté de remplir les blancs du texte. Libre à nous ensuite de penser au lien étymologique entre les mots désignant la parenté dans les langues germaniques. Songeons par exemple au célèbre aparté du premier acte d’Hamlet: « A little more than kin, and less than kind », où kind fait figure de syllepse. Adjectif, il fait référence au « moins que bon » traitement reçu par Hamlet de la part de Claudius, le nouveau roi du Danemark, qui vient de l’appeler « my cousin Hamlet, and my son ». Substantif, il désigne non pas l’espèce, sens premier du nom kind en anglais moderne, mais le lien étroit (également exprimé par kin[kin], mot qui se prononce presque comme le néerlandais kind) qui l’unit à son oncle paternel et nouveau beau-père. Au-delà des différences de prononciation entre l’anglais et le néerlandais, Maeterlinck avait donc vu juste.
17La lettre de 1862, traduite « mot à mot du hollandais » selon la fiction du conte, comporte elle aussi une note. Le narrateur y élucide son emploi du mot « agneau », certes insolite mais nullement incompréhensible pour qui connaît la parabole de la brebis égarée. En néerlandais, « le (pauvre) petit agneau » (het (arm) schaapje), désigne couramment l’enfant en bas âge, surtout l’enfant qu’il faut consoler, comme ici. Sans cette précision, on aurait conclu au mieux à l’effet de style (obtenu en s’écartant sciemment de la norme), au pire au barbarisme, à l’interférence involontaire. La façon dont Maeterlinck gère la lisibilité de son palimpseste devient encore plus claire dans la phrase « elle l’avait laissé seul un clin d’œil, sur le gazon ». Cette fois-ci, ce sont les italiques qui marquent, plus subtilement qu’une note, les traces du substrat néerlandais et renforcent l’impression qu’il s’agit d’un texte traduit6. Le français, il est vrai, connaît l’expression « en un clin d’œil », suffisamment proche pour faciliter la compréhension du passage, mais ici encore, l’auteur se sert d’un calque sémantique. En néerlandais en effet, een ogenblik, littéralement « un clin d’œil », signifie « un instant », la métaphore s’étant lexicalisée7, de sorte que pour exprimer le sens littéral, on dira plutôt oogopslag (« clin d’œil ») ou knipoog (« œillade »). Ce faisant, il met ses lecteurs face à ce qu’un autre écrivain francophone, Abdelwahab Meddeb (1985, p. 126), appellera un siècle plus tard une « provocante étrangeté ». Sans doute hanté par le même habitus linguistique qu’Albert Giraud (pour qui, rappelons-le, le « macaque flamboyant » était « fondé sur l’ignorance absolue de la grammaire, de la syntaxe et de la langue, sur le culte du barbarisme, du solécisme, du flandricisme, du wallonisme, du contre-sens, du non-sens et du pataquès » [Quaghebeur et al., 1990, p. 13]), Maeterlinck tient d’ailleurs à se dédouaner. Il y parvient en présentant le conte tout entier comme une traduction (de l’anglais pour ce qui est de la narration principale, du néerlandais pour ce qui est de la lettre citée), puis en en imputant les maladresses au narrateur, seul responsable des traductions mises en abyme.
Maeterlinck, agent interculturel
18Une fois cette ambiguïté linguistique constatée, on s’étonne qu’il existe si peu d’études (à part Van Elslander, 1962 et Leijnse, 1995) où est examiné le rapport de Maeterlinck à la langue et à la littérature néerlandaises, d’autant que les comparatistes se sont penchés à plusieurs reprises, de Jean-Marie Carré (1926) à Paul Gorceix (1975), sur ses lectures, interprétations et transformations des auteurs anglo-saxons et allemands. Parfois, cette quête de Wahlverwandschaften internationales s’est même faite au détriment du contexte biculturel immédiat de Maeterlinck. Ainsi, Carré (1926, p. 477-482) situe Sœur Béatrice (1901) uniquement par rapport à la tradition allemande, ignorant tout de la Beatrijslegende médiévale, aujourd’hui un classique des lettres flamandes (je l’ai moi-même encore étudiée à l’école secondaire), qui avait été exhumée au xixe siècle. S’il avait découvert le thème chez Nodier et Villiers de l’Isle-Adam, Maeterlinck connaissait le texte flamand et en fit sa source principale, surtout pour le premier acte (Guiette, 1927, p. 347-348 ; Van Elslander, 1962, p. 107). Il n’est pas impossible non plus qu’il ait consulté la magnifique édition art nouveau qui venait de paraître chez l’imprimeur anversois Buschmann, Beatrys. Légende flamande (1901). Le texte moyen-néerlandais y était accompagné de ses traductions française, anglaise et allemande (Guiette, 1927, p. 351). Maeterlinck devait en effet souvent à un relais francophone la découverte d’œuvres flamandes ou néerlandaises, traditions auxquelles ses maîtres jésuites du collège Sainte-Barbe, ceux-là mêmes qui interdisaient à leurs élèves de parler « flamand », ne l’avaient bien sûr pas initié. On sait, grâce aux travaux de Raymond Pouilliart (1962a et b), que ce fut même le cas pour le mystique brabançon Jan van Ruusbroec, traduit directement à partir du texte moyen-néerlandais mais en réaction à la version, indirecte car basée sur un intermédiaire latin, d’Ernest Hello (version sur laquelle Huysmans avait attiré l’attention dans À rebours).
19C’est ici qu’il faut apporter quelques précisions. Aujourd’hui encore (et donc à plus forte raison au xixe siècle), il existe des différences (avant tout phonétiques, mais également lexicales – archaïsmes, gallicismes – et morphosyntaxiques – la formation des diminutifs, les formes du tutoiement) entre le néerlandais des Pays-Bas et celui parlé en Belgique flamande. Ces différences n’en font cependant pas deux idiomes distincts, comme on l’entend parfois affirmer par des gens qui (comme par hasard) ignorent l’un et l’autre. Le néerlandais de Belgique (erronément appelé « flamand », du moins depuis la codification et la standardisation survenues au milieu du xxe siècle) n’est pas plus une langue à part que ne le sont l’allemand de l’Autriche ou le français du Québec. En outre, les différences signalées s’effacent à l’écrit, l’orthographe et la grammaire néerlandaises ayant été uniformisées dans les années 1950-1960. En témoigne le Van Dale, dictionnaire qui fait autorité dans toute la « néerlandophonie » et qui est élaboré par une équipe mixte de lexicographes néerlandais et flamands (cette harmonisation explique à son tour, et pour cause, l’absence de dictionnaires « néerlandais-flamand »). Ainsi, dans l’univers fictif d’« Onirologie », c’est le néerlandais des Pays-Bas qui affleure sous le texte français, mais on aurait tort d’y voir une langue radicalement différente, même si l’uniformisation linguistique était loin d’être complète à l’époque de Maeterlinck. Plus même, d’ardents défenseurs des variétés régionales pratiquées dans une Flandre restée profondément catholique s’opposèrent au rapprochement avec des Pays-Bas majoritairement protestants (De Vries, Willemyns et Burger, 2003, p. 119-120). Or, ce sont les adversaires de ces « particularistes », les dits « intégrationnistes » qui ont eu gain de cause, parce que l’on sentait bien qu’il y avait une parenté étroite entre la langue policée du Nord et du Sud. Même Onésime Reclus, qu’on ne soupçonnera pourtant pas de sympathies à l’égard du « flamand », l’appelait un « dialecte bas-allemand à peu près identique au hollandais » (1886, p. 415-416).
20Dans ces mêmes années, qui sont aussi celles où il traduit Ruusbroec et écrit « Onirologie », Maeterlinck remplit un célèbre carnet de notes (le Cahier bleu) où une large place est dévolue aux réflexions métalinguistiques (voir Gorceix, 1992 ; Angelet, 1999). On y trouve notamment une rêverie rimbaldienne sur la « couleur des langues » qui constituent son propre répertoire linguistique. Le français y est blanc, l’anglais « vert-bleu », le latin « or moiré », l’allemand « limoneux et noir » et « le Flamand-Hollandais : brunâtre » (Maeterlinck, 1977, p. 147, fo 47). La composition chromatique retiendra moins mon attention que l’association entre les deux parlers. Maeterlinck, dont il ne faut pas oublier qu’il avait passé une bonne partie de son enfance à « Ostacker [Oostakker], c’est-à-dire Champ du Levant » (Maeterlinck, 1948, p. 31), commune rurale située à moins de 15 km de la frontière des Pays-Bas, sur le canal Gand-Terneuzen, la souligne à l’aide d’un trait d’union (qui en fait en l’occurrence la force).
21Ce qui précède nous invite à nuancer le portrait des écrivains flamands d’expression française présenté par une certaine historiographie belge. Leurs attitudes comme leurs compétences linguistiques s’avèrent en effet nettement plus ambiguës et complexes, plus modernes aussi, que ce que l’on a bien voulu dire. Pour marginalisé qu’il fût dans leur vie professionnelle, le dialecte flamand local jouait un rôle certain dans l’imaginaire de plusieurs d’entre eux. Certes, chez les Maeterlinck, « On avait décidé que nous apprendrions l’anglais et l’allemand outre le français qui était notre langue maternelle, sans parler du flamand réservé pour les rapports avec les domestiques. » (1948, p. 36) Mais ces derniers échanges ne supposaient-ils pas un minimum de compétences dans la langue du peuple8 ? Cela devait a fortiori être le cas pour la communication au-delà des murs de la maison. Un autre Gantois francophone, Christian Angelet, a pu décrire Maeterlinck comme un « Flamand qui [en tant qu’écrivain] renonce à la langue dans laquelle il baigne sitôt qu’il quitte la maison et qu’il descend dans la rue » (1999, p. 16).
22De fait, si l’aristocratie et la grande bourgeoisie gantoises parlaient à peu près exclusivement le français, il n’en allait pas de même pour les classes moyennes, beaucoup plus nombreuses, qui pratiquaient ce que l’on a pu appeler un « bilinguisme de promotion », où le français se taillait la part du lion : c’était la lingua del pane, la langue des emplois mieux rémunérés et, partant, la seule langue d’instruction admise dans l’enseignement supérieur et même secondaire (Grutman, 2003). Avant qu’ils n’apprennent à lire et écrire cependant, ce qu’ils ne firent qu’en français, la plupart de ces petits Flamands parlaient aussi un dialecte flamand. Ce fut le cas de Maurice Maeterlinck (Hellens 1962b). Contrairement à Émile Verhaeren, il réussit à maintenir sa connaissance de la langue du peuple. Il eut même à s’en servir au cours de sa courte carrière d’avocat : « De temps en temps, un pauvre paysan vient me demander de le défendre, et je plaide, – en flamand », confie-t-il à Jules Huret (1891, p. 118), venu l’interviewer pour sa vaste Enquête sur l’évolution littéraire. Maeterlinck semble avoir gardé toute sa vie « un accent gantois [assez] prononcé » pour que Franz Hellens (1962a, p. 23), qui l’avait fréquenté pendant la Première Guerre mondiale, ait pu se demander si c’était par affectation9. L’Anversois Marnix Gijsen (1965, p. 51-52), qui fit sa connaissance à New York en 1940, rapporte le même détail et insiste sur l’écart entre l’accent du prix Nobel et celui de la comtesse Maeterlinck, la Niçoise Renée Dahon. On sait enfin que celui qui avait signé « Mooris Maeterlinck » ses premiers textes dans La Pléiade, insistait pour qu’on prononce son nom à la flamande, avec un [a:] long et sans voyelle nasale, plutôt que de le faire rimer avec carlingue (Halls, 1960, p. 3).
23Avec l’écrivain naturaliste Cyriel Buysse, qui fut son ami pendant plus de trente ans, Maeterlinck parlait volontiers le dialecte de leur province natale, la Flandre Orientale : Buysse rapporte ce détail dans le récit de voyage Per auto (1913), témoignage qui sera plus tard confirmé par la veuve de Maeterlinck (Halls, 1960, p. 4). Détail digne d’intérêt, Buysse, issu du même milieu, avait brièvement songé à faire carrière en français, écrivant dans les années 1895-1896 plusieurs nouvelles (dont une qui parut à Paris, dans la prestigieuse Revue blanche) et quelques pièces de théâtre dans la langue de Molière (van Parys, 2007, p. 207-234). Maeterlinck l’avait encouragé dans cette voie, mais n’hésitait pas, quelques années plus tard, à féliciter son ami d’avoir définitivement opté pour les lettres néerlandaises : « Je crois que vous avez très bien fait de revenir carrément à notre flamand maternel. Vous y avez gagné une aisance, une abondance, une saveur étonnantes » (lettre citée par Van Elslander, 1962, p. 97 ; Van Nuffel, 1962, p. 29).
« Le substratum suggestif »
24Si « Onirologie » peut donc être considéré comme un palimpseste, ce n’est pas parce qu’il aurait été traduit d’une autre langue, enfouie dans la mémoire de l’auteur (même si le conte est présenté comme tel par un narrateur anglophone d’origine néerlandophone), mais bien plutôt parce que ce texte n’existerait pas sous cette forme sans la polyglossie de Maeterlinck. Le dialecte flamand parlé avec les domestiques à Gand ou avec les paysans à Oostakker lui a servi de tremplin vers le néerlandais standard, puis vers d’autres langues germaniques : l’allemand, l’anglais (qui apparaissent constamment sous sa plume dans les essais réunis dans L’Hôte inconnu, par exemple), voire l’afrikaans, comme l’a récemment rappelé David Van Reybrouck (2001).
25Maeterlinck était conscient de l’avantage concurrentiel que lui donnait cette maîtrise linguistique dans le champ littéraire français. Dans un passage du Cahier bleu, il égratigne ses confrères unilingues, remarquant « l’énorme infériorité de ceux de la nouvelle génération latine qui ne sont pas polyglottes » (1977, p. 153, fo 52). Grâce aux lectures qu’il pouvait faire dans toutes les langues mentionnées sans avoir à attendre que des traductions françaises fussent disponibles sur le marché, et sans dépendre des traductions existantes, pas toujours fiables, il arrivait à donner à ses propres œuvres un cachet inédit et distinctif, une image de marque. C’est également le cas, on ne sera pas surpris de l’apprendre, d’« Onirologie », véritable Traumnovelle remplie d’échos et de clins d’œil intertextuels, dont la plupart font référence à des œuvres étrangères. Que Maeterlinck ait largement puisé dans ses lectures anglo-saxonnes (Quincey, Poe, Hood, lus dans le texte après les avoir découverts chez Baudelaire) n’étonnera pas. Qu’il se soit également abreuvé aux lettres néerlandaises n’a, en revanche, guère été relevé.
26Revenons à la lettre citée. Tant les patronymes (van Brammen, van Naslaan) que les prénoms (Saartje, puis Meeltje) des personnages font très « hollandais », couleur locale qui renforce l’illusion de la traduction. Cela est d’autant plus vrai qu’ils apparaissent tous, sans exception, dans les anecdotes réunies sous le titre de Camera obscura (1839) par un auteur néerlandais très populaire au xixe siècle (qui de surcroît habitait à Utrecht, la ville d’où aurait été envoyée notre lettre) : Nicolaas Beets, dit Hildebrand10. Cela vaut également pour le notaire Hendrik Jo(h)annes Bruis, chez qui les papiers du défunt père du narrateur auraient été déposés. Quelques-unes des histoires de Hildebrand avaient paru à Paris sous le titre balzacien de Scènes de la vie hollandaise (1856), dans une traduction du Belge Léon Wocquier, alors le traducteur attitré d’Henri Conscience; les autres devaient suivre de peu, dans La Chambre obscure(1860). Il faudrait vérifier si Wocquier a maintenu les noms néerlandais dans sa version, auquel cas Maeterlinck aurait bien pu y puiser son inspiration. Cela est d’autant plus plausible que les noms qu’il emploie apparaissent dans trois histoires traduites dès 1856, soit « Une vieille Connaissance » pour Bruis, « La famille Stastok » pour Meeltje (un diminutif d’Amélie) ainsi que les dames van Brammen et van Naslaar, puis « La famille Kegge » pour Saartje. Dans ce cas-ci, Maeterlinck aurait donc pu se passer de l’original. Il n’est pas non plus certain qu’il ait voulu faire allusion à Beets : le clin d’œil est trop discret, si discret même que le procédé prend presque des allures de dissimulation.
27Rien de tel, toutefois, dans l’incipit du conte, qui rend plus explicitement hommage à une autre œuvre marquante du xixe siècle néerlandais, œuvre que Maeterlinck, cette fois-ci, semble bien avoir lue dans le texte. Voici cet incipit :
Je descends d’une vieille et placide famille hollandaise. Mon père était ce qu’on appelle en néerlandais adsistent-resident de Lebak en l’île de Java. J’ignore tout, hélas ! de sa vie et de ses aventures, à l’exception de ses démêlés, célèbres à cette époque, avec le régent indigène, Radhen Adhipatti Karta Natta Negara, dont j’ai lu, bien des soirs, le bizarre et tranquille récit dans les collections du Javasche Courant et du Nieuws van den Dag d’Amsterdam. Il est allé aux colonies avec ma grand-mère et y mourut lorsque je n’avais pas encore atteint ma deuxième année.
28Ce fonctionnaire colonial a vraiment existé et il a vraiment démissionné (en 1856) après avoir essayé en vain de mettre fin aux abus de pouvoir de quelques chefs javanais. Il s’appelait Eduard Douwes Dekker, mieux connu comme Multatuli, le pseudonyme sous lequel parut en 1860 Max Havelaar. Ce roman-pamphlet qui dénonce l’exploitation des colonies par une Europe sans scrupules a été proclamé en 2002 « l’œuvre littéraire la plus importante de tous les temps écrite en langue néerlandaise11 » par la vénérable Société de littérature néerlandaise (Maatschappij der Nederlandse Letterkunde), fondée à Leyde en 1766.
29Cette fois-ci, Maeterlinck a eu recours à la version néerlandaise. Deux détails m’ont mis la puce à l’oreille, telles ces « syllepses » ou « non-grammaticalités » qui signalent selon Riffaterre (1979, 1980) la présence d’un intertexte. Le premier est une bizarrerie orthographique : en néerlandais, on dit et écrit assistent plutôt qu’adsistent, le groupe consonantique -DS s’étant réduit à -SS. Or, vérification faite dans l’édition critique de Max Havelaar, Multatuli (1992, p. 39) se servait encore de l’orthographe plus latinisante. Les noms exotiques de l’administrateur autochtone de Lebak, Radhen Adhipatti Karta Natta Negara (ibid.) constituent l’autre indice. Maeterlinck n’a pu les trouver dans la seule traduction complète alors disponible, car celle-ci ne respectait guère l’altérité linguistique créée dans l’original par les nombreux mots javanais et malais. Les traducteurs, Adrien-Jacques Nieuwenhuis et Henri Crisafulli, les avaient simplement omis (quitte à supprimer des phrases entières), ou leur avaient trouvé des « équivalents » français12. Maeterlinck ne pouvait pas non plus avoir trouvé ces détails dans une autre traduction qui circulait alors en Belgique et qu’il a dû connaître, vu qu’elle venait de paraître dans La Société nouvelle, revue à laquelle il collaborait lui-même (il y insère « La princesse Maleine » en 1889-1890). La traduction préparée par Neel Doff est toutefois partielle : intitulée « Last et Co, Canal des Lauriers n° 37 », elle ne comprend que les quatre premiers chapitres, qui correspondent au récit-cadre fait par un autre personnage que Havelaar, le tristement célèbre courtier en café Batavus Droogstoppel. Quant à Havelaar, il ne prend la parole qu’au cinquième chapitre, où apparaît une première fois le chef javanais Adhipatti Karta Natta Negara13.
30Une fois de plus, l’intérêt de Maeterlinck pour une œuvre de langue néerlandaise a été éveillé par une traduction française. Ici encore, il semble avoir saisi l’occasion pour avoir accès à l’original. Grâce à sa connaissance du « flamand-hollandais », véritable « substratum suggestif » (Maeterlinck, 1977, p. 138, fo 37), il a pu lire Max Havelaar dans le texte, comme il l’avait fait pour Ruusbroec en 1885 et comme il devait le faire pour Beatrijs en 1900.
Conclusion
31« Onirologie » apparaît ainsi comme une vaste fiction linguistique, une rêverie sur les langues, et à ce titre, un palimpseste postcolonial avant la lettre. Les calques du néerlandais ne s’expliquent point, bien entendu, par la maîtrise insuffisante qu’aurait eue Maeterlinck du français, sa seule langue d’écriture, mais plutôt par sa volonté de discrètement inscrire sa différence linguistique. Dans ce texte apparemment unilingue, apparaît en filigrane la langue des origines, celle qui, de l’avis d’Émile de Laveleye, continue de nous hanter même quand nous l’avons (ou croyons l’avoir) oubliée. Que le fils fictif d’Eduard Douwes Dekker (dont j’ai déjà noté qu’il a le même âge que l’auteur d’« Onirologie ») redécouvre le néerlandais des Pays-Bas, plutôt que le dialecte qui avait résonné aux oreilles du jeune Gantois, ne change rien au double fait que ce dernier a choisi, d’une part, de faire changer de langue son protagoniste (chose dont ni Quincey ni Poe ne sont coutumiers) et, d’autre part, d’avoir recours à une langue qu’il maîtrisait réellement, à savoir « le flamand-hollandais » du Cahier bleu. Ce faisant, Maeterlinck tient à égale distance le fantasme du parler privé (dont l’espagnol rapiécé de Victor Hugo est un bel exemple) et celui de l’idiome ancestral (dont le cas classique demeure le yiddish rêvé de Kafka). Une génération plus tard, pour le Bruxellois Michel de Ghelderode, la Flandre sera devenue un songe; pour le Flamand de 1889, par contre, elle est encore bien réelle.
32Il va sans dire que la démarche de Maeterlinck paraîtra timide par rapport à ce que l’on trouve dans la francophonie d’aujourd’hui, où les écrivains revendiquent avec beaucoup plus d’aplomb leur identité hybride. Pour récentes qu’elles soient, les expériences des Chamoiseau et Confiant, des Khatibi et Meddeb ne nous autorisent pas moins à considérer de nouvelle façon l’œuvre de certains « francographes » du passé, tels ces Flamands d’expression française dont j’ai essayé de montrer la complexité biculturelle. Instruits par la lecture des corpus postcoloniaux, nous pouvons réévaluer les conséquences littéraires, culturelles et identitaires qu’eut le fait de grandir dans un milieu diglossique, où l’on parlait français au salon et « causait patois » dans la cuisine.